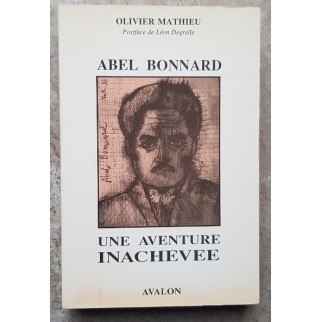Testament politique - Abel Bonnard
Abel Bonnard, « Testament politique » (1962), dans Abel Bonnard ou l’aventure inachevée, éd. Avalon, 1987, p. 355-360.
Ce qui nous a d’abord distingués, dans la crise de 1940, c’est que nous n’avions pas voulu cette guerre que la France ne faisait pas pour ses propres intérêts et à laquelle elle avait d’ailleurs répugné de tout son instinct. Ce qui nous a ensuite caractérisés, c’est qu’une fois l’écrasement survenu, nous n’avons pas voulu revenir à la lutte stérile et maudite des partis, mais, au contraire, faire une œuvre à laquelle tous les hommes de bonne volonté pussent être conviés, celle-là même qui n’avait pas été accomplie avant la guerre : subjuguer la défaite, l’attacher au char embourbé de la France, la forcer à servir à sa renaissance. On en revenait à cette réforme intellectuelle et morale dont Renan, après l’autre défaite, avait préconisé la nécessité, mais dans des conditions immensément élargies, où il s’agissait de refaire la France en faisant l’Europe. Les deux choses se tenaient ; elles demandaient, sur un solide fond de raison, un mouvement de générosité et de foi. Il s’agissait essentiellement, dans la politique intérieure, de réintégrer le peuple dans la communauté nationale, comme, dans la politique extérieure, de réunir les différents peuples de l’Europe dans une communauté internationale.
Ce programme était grandiose et il n’était pas chimérique, il dessinait seulement le plus haut possible. Il y eut alors, en France, en Belgique. en Allemagne, et, indirectement, dans toute l’Europe, non seulement une espérance, mais une aspiration générale vers une paix, non plus accidentelle et précaire, mais positive, fixée, fondée sur un ordre intérieur et extérieur. Ce fantôme endimanché de l’Europe qui se promenait depuis si longtemps dans les hauteurs de la culture, allait enfin descendre dans la politique pour s’y incarner, tout en gardant ses parures. Cette constitution de l'Europe devait avoir nécessairement pour noyau l’association sincère et profonde de la France et de l’Allemagne. Les grandes figures de notre passé ne manquaient pas pour patronner cet accord, Renan, Tocqueville, Hugo, Lyautey, bien d’autres encore. Il semblait qu’il fût enfin temps, pour les deux pays, de mettre fin au stupide et fastidieux dialogue de tueries où ils détruisaient à l’envi et sans aucun fruit ce qu’ils avaient de meilleur. Cette constitution de l’Europe restait cependant chargée de promesses pour chacune des nationalités qui y prendraient part puisqu’il n’était pas question d’une Europe en grisaille, d’une Europe d’uniformité, mais, au contraire, d’un réveil de toutes les âmes nationales dans une société commune. Le symbole de cette Europe harmonique et régénérée, c’était, comme je ne m’étais pas lassé de le redire, le signe même de la paix, l’arc-en-ciel, où chaque couleur existe dans l’intensité du ton pur, tout en se fondant avec ses voisines sur ses bords fluides.
Il faut considérer d’autre part ce que fut l’action de l’Allemagne dans cette crise. Non seulement beaucoup d’Allemands parmi les meilleurs ont souhaité profondément et parfois passionnément un rapprochement décisif avec la France, mais Hitler lui-même a reconnu qu’il était nécessaire â la formation d’une Europe. Toute une suite d’actes de lui atteste ses intentions, et à la fin, dans la sincérité désespérée de ses derniers jours, quand il recherche les causes de son désastre, il en voit une des plus certaines dans son désir de collaborer avec la France. Mais puisqu’il voulait cette collaboration, sa faute est de ne pas l’avoir voulue assez fortement. C’est dès 1940 qu’il fallait convier solennellement, audacieusement, les peuples de l’Europe continentale à entrer dans un nouvel âge. Quand, ensuite, il reporta ses forces contre la Russie des Soviets, comme contre le seul adversaire qu’il aurait voulu avoir à combattre, au lieu d’accueillir presque à contrecœur ces volontaires européens, élite obscure, qui, ayant compris le sens du drame, offrirent leur vie en témoignage de leur conviction, il fallait les accueillir avec gloire, et accompagner cet accueil de déclarations irrévocables. Napoléon aussi, quoique les circonstances parlassent alors moins impérieusement a vu s’offrir à lui cette idée de constituer l’Europe qui se présente à l’homme de puissance comme une tentation ou comme un devoir, mais, lui aussi, se laissa distraire ou absorber par le train des affaires et les vicissitudes des événements.
L’Action française, qui avait toujours eu parmi ses principaux caractères le dogmatisme et l’anachronisme ne voyait dans une conjoncture si démesurée que l’occasion de remporter indirectement, en politique intérieure, l’avantage qu’elle n’avait pas pu s’assurer par ses seules forces, tout en continuant d’arborer le nationalisme de Déroulède. Ainsi l’événement se détraqua de plus en plus, le pouvoir d’Hitler, comme il était déjà arrivé à Napoléon, se crispa et s’envenima à mesure qu’il se réduisait. La guerre se prolongea sans être dirigée par aucune volonté intelligente, pour aboutir enfin à la contradiction la plus stridente, à l’inconséquence la plus dérisoire que présente l’histoire contemporaine, quand les Anglo-Américains, après avoir sauvé, protégé, équipé, fortifié, porté jusqu’à un excès formidable la puissance des Soviets, eurent peur, la victoire en commun à peine obtenue, de ce géant qu’ils avaient formé, la crainte qu’il leur inspire étant restée depuis lors l’élément déterminant de leur politique. Ainsi l’on peut le regarder maintenant avec une nostalgie justifiée, ce moment qui exista vraiment où les pensées des hommes les plus réfléchis coïncidèrent avec les aspirations naïves des bonnes gens et où l’on put croire que l'Histoire allait enfin, une fois, entendre le vœu toujours négligé des mères. Les indices favorables ne manquaient pas. Le vieux chef en qui la France retrouvait ses propres vertus avait compris que la défaite de notre pays n’était pas un accident, mais une sanction et que la première des tâches était de sortir de l’état qui l’avait produite. De même, en se rencontrant d’égal à égal avec le chef de l'Allemagne, il avait indiqué que cette réforme intérieure s’associait naturellement à l’organisation de l’Europe. Parmi l’ancien personnel politique, il y avait d’excellentes exceptions, des hommes qui, plus au fait que personne des vices pernicieux de l’ancien système, gardaient de leur expérience un sens très vif des réformes à effectuer. Parmi les partis, le PPF se signalait par un brillant état-major ; enfin, se trouvaient dispersés dans toutes les professions des hommes d’une capacité éprouvée, sérieux, laborieux, consciencieux, persévérants, désintéressés, comme la France n’a pas a cessé d’en produire et dont les grands intendants du XVIIIe siècle restent le modèle.
Ce qui manquait, ce n’était pas le désir, c’était plutôt le ressort. C’était le chef énergique qui aurait pétri ces éléments divers pour engager la nation dans une œuvre où se serait volatilisé le sentiment de sa défaite militaire. Ainsi commença lentement de s’effacer la possibilité unique qui avait vaporeusement brillé sur les choses. Ainsi la glaise sécha sans avoir été modelée. Je ne me fis pas faute, pour ma part, de répéter, alors, que la guerre devait être le premier acte du drame, mais non tout le drame, sous peine d’aboutir à une confusion aussi informe que celle qui avait suivi l’autre guerre. En même temps, à mesure que la victoire allemande devenait moins certaine, bien des gens que l’événement avait d’abord assommés, se demandèrent s’ils ne s’étaient pas effrayés trop vite et s’ils n’allaient pas voir se rétablir une décadence commode à leurs intérêts, à leurs profits, à leur importance et à leur paresse. D’autres, animés d’un patriotisme irritable et touchant ; mais incroyablement étriqué et suranné, en face du drame cosmogonique où était ballotté le sort des Empires, pensaient que l’Angleterre, puis les États-Unis allaient se trouver trop honorés de combattre pour la France, et cette idée flattait la vanité nationale, quoique à mon sens il soit plus humiliant de vouloir être vainqueur par les autres que d’être vaincu soi-même.
Si l’on me permettait ici une brève digression, peut-être pourrait-on dire, si paradoxal que cela paraisse, que ce qui caractérise ces monstres de l’action dont on veut nous faire admirer l’énergie, c’est en quelque sorte la timidité. Leur énergie, en effet, peut facilement s’exaspérer jusqu’à la violence mais en restant toujours sur le même plan. Quand il s’agit de hausser l’Histoire, ils hésitent, tergiversent, temporisent, et finalement ne font point le pas décisif. Ainsi le possible garde des profondeurs vierges, au-dessus des tristes bagarres de l’Histoire horizontale.
Maintenant, tout est dit. Dans ces convulsions prodigieuses, l’action intelligente n’a pour intervenir qu’un moment, on pourrait presque dire qu’une fissure. Désormais, les événements se font tout seuls. On est entré dans une période géologique de l’Histoire, qui peut se caractériser aussi bien par des effondrements subits que par des engourdissements infinis, tandis qu’une réalité inconnue monte lentement vers la surface des choses. Tout se tient, aucun problème ne peut plus être encadré, étudié, résolu isolément par l’esprit. Des événements d’une brutalité écrasante s’imposent par leur masse, c’est l’énorme irruption de la Chine dans le drame universel, c’est la fin du règne de l’homme blanc, qui prend la forme d’une abdication. A la gigantesque impéritie des États-Unis correspond l’irréconciliable malignité des Soviets. Le désastre de l’homme s’étend à toute la terre. Quant à nous, qui fûmes les artisans ou les chevaliers malheureux d’un plus beau possible, nous sommes aussi vaincus qu’on peut l’être, abolis, annulés. Mais personne n’est vainqueur. Où nous avons voulu fonder un ordre, un abîme s’ouvre. Il arrive ce que nous nous étions expressément proposé d’éviter : le monde tombe dans le chaos.
Source