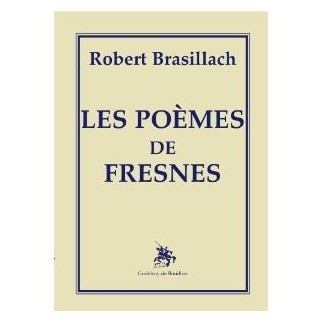Le Testament d’un condamné - Robert Brasillach
Robert Brasillach, « Le Testament d’un condamné (22 janvier 1945) », in Les poèmes de Fresnes, éd. Godefroy de Bouillon, 2003 (ISBN 9782841911004), pp. 48-56.
L’an trente-cinq de mes années,
Ainsi que Villon prisonnier,
Comme Cervantès enchaîné,
Condamné comme André Chénier
Devant l’heure des destinées,
Comme d’autres en d’autres temps,
Sur ces feuilles mal griffonnées
Je commence mon testament.
Par arrêt, des biens d’ici-bas
On veut me prendre l’héritage.
C’est facile, je n’avais pas
Terre ou argent dans mon partage.
Et mes livres et mes images
On peut les disperser aux vents
La tendresse ni le courage
Ne sont objets de jugement.
En premier mon âme est laissée
A Dieu qui fut son Créateur,
Ni sainte ni pure, je sais,
Seulement celle d’un pécheur,
Puissent dire les saints français,
Qui sont ceux de la confiance,
Qu’il ne lui arriva jamais
De pécher contre l’espérance.
Quel don offrir à ma patrie
Qui m’a rejeté d’elle-même ?
J’ai cru que je l’avais servie
Même encore aujourd’hui je l’aime.
Elle m’a donné mon pays
Et la langue qui fut la mienne.
Je ne puis lui léguer ici
Que mon corps en terre inhumaine.
Et puis, je laisse mon amour,
Et mon enfance avec mon cœur,
Le souvenir des premiers jours,
Le cristal, le plus pur bonheur,
Ah ! je laisse tout ce que j’aime,
Le premier baiser, la fraîcheur,
Je laisse vraiment tout moi-même,
Ou, s’il existe, le meilleur.
A toi, à la première image,
Au sourire sur mon berceau,
A la tendresse et au courage,
A la féérie des jours si beaux.
Soleil même dans les sanglots,
Fierté aux temps les plus méchants,
Pour qui rien ne change à nouveau
L’âge qu’a toujours ton enfant.
Et pour toi, ma sœur, mon amie,
(J’ai passé, ah ! si peu de temps
Loin de toi, toute notre vie
Nos cœurs du même battement
Ont battu). Ce que je laisse
C’est nos greniers des vieux printemps,
C’est les jeux de notre jeunesse,
Nos promenades d’étudiants.
C’est parmi la neige glacée,
La gaieté qui restait la tienne,
Le sourire que tu faisais
Par delà les grilles lointaines,
Toi si fière, ô toi indomptée,
Rieuse parmi les déveines,
Mon amie de tous nos étés,
Ma sœur des joies comme des peines.
A toi encor que j’ai vu naître,
Comme une enfant de mes douze ans,
Petite sœur, à la fenêtre
Tu vins aussi aux jours pesants.
A toi tout ce qui nous assemble,
Le mépris des cœurs trop fuyants,
Le silence qui nous ressemble,
Et l’amour qui n’est pas bruyant.
Petits enfants de ma maison,
O vous qui ne m’oublierez pas,
(Et peut-être d’autres viendront)
Vous m’avez donné ici-bas
Vos joues, l’étreinte de vos bras,
Votre sommeil sur qui je veille :
Je vous appelle ici tout bas,
Je vous rends toutes ces merveilles.
Et maintenant, à toi, Maurice
A toi, frère de ma jeunesse,
Que te donnerai-je qui puisse
N’être à toi de ce que je laisse ?
Voici Paris qui fut à nous,
Voici Florence qui se dresse,
Et, sur les chemins secs et roux,
Voici notre Espagne sans cesse.
Mais voici surtout, ô mon frère,
Le cœur de notre adolescence
Nul hasard ne le désespère,
A tout il garde confiance.
Au destin même bien masqué
Nous disions oui d’une voix claire,
Quel qu’il fût.
Et rien n’a manqué
Aux cadeaux qu’il pouvait nous faire.
Bien ou mal, acceptons le lot !
Je le lui rends, tout pêle-mêle.
Mais je te laisse le plus beau,
Nos dix-sept ans, l’aube nouvelle,
La couleur du matin profond,
Nos années pareilles et belles,
Les enfants dans notre maison,
Et notre jeunesse immortelle.
Et puis, voici, pour mes amis,
Chacun leur carte-souvenir.
Vous d’hier, et vous d’aujourd’hui,
Vous m’entourez sans vous enfuir,
Vous allumez sur mon passage
Le plus beau feu de l’avenir.
Je tends mes mains à vos images,
Elles me gardent de frémir.
Cher José[1], voici la Cité,
Et la Cour de Louis-le-Grand.
Georges[2], pour un futur été,
Voici la route dans les champs.
Henri[3], voici les quais de Seine,
Et les livres à feuilleter,
Et le pays de la Sirène
Que nous aurions dû visiter.
Voici les Noëls de Vendôme,
Notre-Dame des pèlerins.
Le passé fut si beau en somme
Qu’il ne faut blâmer le destin.
Jusqu’au bout de nos années d’homme
Nous aurons gardé le meilleur,
Le savoir de ce que nous sommes,
La jeunesse de notre cœur.
Et pour toi, depuis si longtemps
De l’adolescence surgie,
Je n’ai que d’étranges présents
A te laisser, ô mon amie :
Moins de joie, c’est sûr, que de peines,
L’asile où j’abritais ma vie
Au cœur des mauvaises semaines,
Et ce qui jamais ne s’oublie.
Pour vous, les frères de la guerre,
Les compagnons des barbelés,
Fidèles dans toutes misères,
Vous ne cessez de me parler.
Voici nos neiges sur le camp,
Voici nos espoirs d’exilés,
Notre attente de si longtemps,
Notre foi que rien n’a troublée.
Et vous, garçons de mon pays,
Voici les mots que nous disions,
Nos feux de camp parmi la nuit,
Et nos tentes dans les buissons.
Vous le savez mieux que personne,
J’ai voulu garder ma patrie
Du sang versé, et je vous donne
Ce sang gardé, ô mes amis.
Cher Well[4], notre sainte colline,
Le petit peuple du marché,
Le rue grouillante où l’on chemine,
Les charrettes des maraîchers,
Ils sont à toi, ami têtu,
Qui dans l’ombre toujours devines
Ce que l’espoir jamais battu
Malgré l’apparence dessine.
Et pour vous les derniers venus,
Compagnons des sombres journées,
O captifs des cachots reclus,
Gardez mes heures condamnées,
Gardez le froid, gardez l’ennui :
Pour ceux qui ne les auraient plus,
Ce sont des trésors eux aussi.
Avec vous je les ai connus.
Quelques ombres, quelques visages
Ont droit encore à quelques grains
Finissons vite le partage
Avant que vienne le destin.
Tous ceux-là qui, garçons ou filles,
Sont venus couper mon chemin
Peuvent bien dans la nuit qui brille
Attendre avec moi le matin.
Pour eux tous j’avais les mains pleines
Elles sont vides maintenant
Des images les plus lointaines,
Du passé le plus émouvant.
Je ne garde pour emporter
Au-delà des terres humaines
Loin des plaisirs de mes étés,
Des amitiés qui furent miennes,
Que ce qu’on ne peut m’enlever,
L’amour et le goût de la terre,
Le nom de ceux dont je rêvais
Au cœur de mes nuits de misère,
Les années de tous mes bonheurs
La confiance de mes frères,
Et la pensée de mon honneur
Et le visage de ma mère.
Fresnes, 22 janvier 1945.
Notes
- ↑ José Lupin, ami de Robert Brasillach au lycée Louis-le-Grand. Il est souvent cité dans Notre avant-guerre.
- ↑ Georges Blond.
- ↑ Henri Poulain, ami fidèle de Robert Brasillach pendant ses dernières années.
- ↑ Well Allot, aujourd’hui François Brigneau, qui habitait rue Mouffetard, tout près de la rue Rataud, où était le domicile de Robert Brasillach.
Source